Au musée de Meaux, ce samedi, une université d’été consacrée aux chevaux dans la Grande Guerre
La nouvelle édition de l’université d’été du musée de la Grande Guerre, présidée par François Cochet, est dédiée à la place des équidés dans la Grande Guerre, en lien avec l’exposition temporaire et se déroulera le samedi 5 juillet 2025 de 9 h à 18 h.
Les intervenants présenteront leurs recherches et leurs travaux sur ce sujet (la cavalerie, l’utilisation des chevaux à l’arrière, etc…). Une visite guidée de l’exposition « Des chevaux et des hommes » menée par la responsable de la conservation complètera ce rendez-vous d’historiens, chercheurs et professionnels.
Voici le programme de la journée d’université d’été « Les chevaux dans la Grande Guerre »:
9h30-10 h : Introduction et ouverture de l’université d’été avec François Cochet, historien, professeur émérite à l’université Lorraine-Metz et président de l’université d’été du musée.
10h-10h45 : Les chevaux de la 2e division de cavalerie dans la Grande Guerre
Lieutenant-colonel Jean Bourcart, officier historien de l’armée de Terre. En 1873, au départ des dernières troupes d’occupation allemande, la 2e division de cavalerie (2e DC) s’installe en garnison à Lunéville, cité cavalière par excellence placée dès lors sous une double influence, celle de l’extrême frontière et celle du cheval d’armes. Reconnue comme la seule division de cavalerie d’importance aux avant-postes de la Lorraine annexée, elle est régulièrement mentionnée dans la presse comme une division d’exception jusqu’en 1914.
Aux premiers jours de la Grande Guerre, les trois brigades de cavalerie de la 2e DC prennent leurs emplacements de couverture. Commence alors une longue période éreintante découpée seulement de quelques escarmouches d’avant-postes mais pendant laquelle cavaliers et chevaux s’anémient. Toutefois, durant tout le conflit, en Lorraine, en Champagne puis dans la Somme, « montée » ou « démontée », la 2e DC ne faillit pas à sa triple tâche de reconnaître, couvrir et combattre, seule ou en liaison avec les autres armes, malgré l’absence d’un temps long du mouvement qui nourrit la frustration des troupes montées et éloigne le cheval du combat. Au-delà des hommes et des structures évolutives qui organisent une division de la cavalerie française pendant la Grande Guerre, le cheval en son sein est donc lui aussi un sujet d’étude digne d’intérêt en tant que « compagnon combattant » du cavalier pendant tout le conflit mondial. Par l’évocation d’une grande unité de cavalerie, la 2e DC, et du rôle de ses chevaux, cette communication se propose donc de s’intéresser à une force équestre qui est bien, elle aussi, une force de cavalerie en guerre.
10h45-11h30 : Cheval, Bretagne et Grande Guerre : quelques éléments prospectifs
Erwan Le Gall, Docteur en histoire contemporaine de l’Université Rennes 2, chercheur associé au Centre de recherche bretonne et celtique (CRBC EA – 4451 / UMS 3554), professeur-référent Hautes études internationales et politiques (HEIP, campus de Rennes). La Première Guerre mondiale a beau, aujourd’hui encore, être indissociable d’une histoire de la modernité technique, de l’augmentation invraisemblable de la puissance de feu et des moyens de donner la mort, il n’en demeure pas moins que l’innovation n’est nullement régie par un schéma positiviste. La Bretagne ne fait de ce point de vue nullement exception et le cheval y tient, entre 1914 et 1918, une place essentielle. Cette histoire est tout autant logistique et militaire qu’économique et politique, culturelle et même affective, interrogeant ainsi les liens entre l’homme à l’animal.
11h30-12h30 : visite de l’exposition temporaire sur les équidés dans la Grande Guerre.
Johanne Berlemont, responsable du service conservation au musée de la Grande Guerre
13h30-14h15 : On achève bien les chevaux
Jean-Michel Derex, docteur en histoire (HDR). Lors de la Première Guerre mondiale, les chevaux ont accompagné les combattants pour le meilleur et le pire. Les soldats ne sont pas les seuls à vivre, à souffrir et à mourir sur les champs de bataille : c’est aussi le sort de millions de chevaux, de mules et d’ânes. La guerre est, pour eux, le cruel miroir de celle des poilus tant bêtes et humains sont unis dans les tranchées. L’auteur propose un aperçu de cette vie équestre au front d’abord sur un plan chronologique : en effet, si l’armée française sent encore le crottin en 1914, elle sent déjà le pétrole en 1918. Ensuite sur un plan géographique car les bêtes sont placées sur le front en fonction de leurs missions.
14h15-15h : Les équidés de la Grande Guerre dans les collections numériques de la BnF, des archives à la mémoire vive
Patricia Hodiesne, Gestionnaire de collections en histoire, BnF, Département Philosophie, histoire, sciences de l’homme. Indispensables sur tous les fronts, les équidés de la Grande Guerre n’ont pas laissé leurs contemporains indifférents. Leurs missions, leur sort terrible ont marqué les esprits des soldats comme des civils. De nombreux Poilus souhaitaient qu’un hommage leur soit rendu et parlaient encore d’eux dans l’entre-deux guerres. Ils ont pourtant peu à peu disparu de la mémoire du conflit, avant qu’une nouvelle historiographie remette en lumière leur importance stratégique et leurs « vécus oubliés ». Dès l’approche du Centenaire, ce sont nos contemporains qui se sont exprimés sur ces « animaux soldats », pris dans la tourmente avec d’autres, chiens, pigeons ou mascottes, mais aussi bétail et animaux domestiques ou sauvages, aux côtés des hommes, qu’ils ont portés, ravitaillés, secourus, et souvent soutenus moralement. De Gallica aux Archives de l’internet, les collections numériques de la Bibliothèque nationale de France nous invitent à revisiter leurs parcours, et les regards posés sur eux, de la presse illustrée d’alors aux billets de blogs d’aujourd’hui.
15h15-16h : Les chevaux de la Grande Guerre – Données historiques et archéozoologiques : L’exemple des découvertes du site de Chaillon dans la Meuse
Séverine Braguier, Docteur en Archéozoologie, INRAP Tours. Pendant la Première Guerre mondiale, 1880000 chevaux et mulets participeront à l’effort de guerre. Utilisés pour le transport, la logistique, la cavalerie, la communication, plus de 60% d’entre eux périront entre 1914 et 1918. Depuis quelques années, plusieurs découvertes archéologiques de chevaux apportent des informations qui viennent compléter les sources écrites, photographiques et iconographiques utilisées par les historiens. L’exemple des découvertes faites sur la commune de Chaillon, située dans la Meuse est particulièrement parlant. A partir des 21 et 22 septembre 1914, plusieurs unités allemandes sanitaires vont s’installer sur cette commune (Feldlaz. 8 du IIIe corps bavarois). Le 6 mai 1915 une colonne de munitions, cantonnée depuis avril avec 150 chevaux subira de fortes pertes suite à un bombardement d’obus de 150 mm. La découverte d’un cratère d’obus de fort calibre en limite de chantier, comblé entre autre chose, de paniers de transport de munitions allemandes et situé à proximité de plusieurs carcasses de chevaux, illustre ainsi parfaitement le quotidien des hommes et des animaux stationnés dans la commune.
16h-16h45 : La Grande Guerre des chevaux dans les Archives départementales de Seine-et-Marne
Olivier Plancke, agrégé d’histoire-géographie, chargé de mission recherche et valorisation scientifique et professeur-relais de l’académie de Créteil aux Archives départementales de Seine-et-Marne, Justine Queuniet, cheffe du service de l’Action éducative aux Archives départementales de Seine-et-Marne. Qu’ils soient de labour, de trait, de chasse à courre, de course ou de promenade, les chevaux sont partout en Seine-et-Marne avant la Grande Guerre. Animaux indispensables pour les travaux des champs, les livraisons de marchandises, le transport des personnes, le halage des péniches, les chevaux sont bien loin d’être remplacés par les véhicules à moteur. Recensés et classés comme les jeunes hommes, les chevaux sont, comme eux mobilisés, et nombreux sont ceux qui deviennent des chevaux de guerre. Comme les hommes, les chevaux réquisitionnés partent au combat, sont blessés ou tués. Comme les soldats, les chevaux sont soignés dans des hôpitaux vétérinaires ou ensevelis sur le lieu de leur mort. À l’arrière, les chevaux réquisitionnés manquent tout autant que les hommes entraînant une baisse de la production agricole. Les Archives départementales de Seine-et-Marne conservent dans leurs fonds des collections rarement consultées qui permettent de faire l’histoire de ces chevaux civils et militaires lors de la Grande Guerre.
16h45 : Conclusion
François Cochet, historien, professeur émérite à l’université Lorraine-Metz et président de l’université d’été du musée.
Informations pratiques
Gratuit – sur réservation ici.
Restauration sur place par la Patate à modeler
Toutes les interventions seront filmés par l’APHG et seront diffusées par la suite sur notre chaîne Youtube.
L’article Au musée de Meaux, ce samedi, une université d’été consacrée aux chevaux dans la Grande Guerre est apparu en premier sur Lignes de défense.
Auteur :
Aller à la source

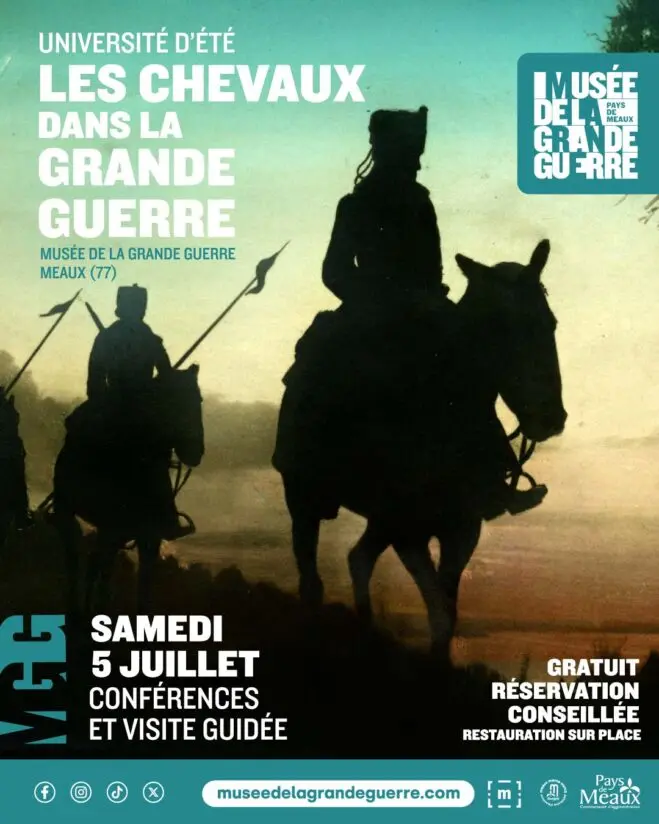



![[#VOLFA2019] L »importance des contrôleurs avancés lors de missions [#VOLFA2019] L »importance des contrôleurs avancés lors de missions](https://militaire.artia13.pro/wp-content/uploads/2025/07/VOLFA2019-Limportance-des-controleurs-avances-lors-de-missions-390x205.webp)
